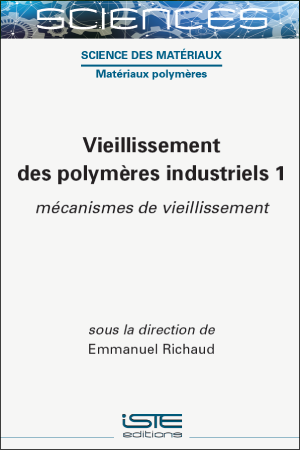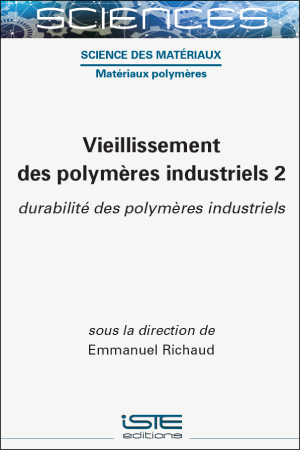– Papier (Collections classiques, Encyclopédie SCIENCES) :
Livraison offerte pour toute commande directe effectuée sur le site istegroup.com
Délai de livraison : environ deux semaines
Envois uniquement vers : France métropolitaine, Belgique, Suisse et Luxembourg
Impression en couleur
Un ebook de l’ouvrage (à l’exception des titres de l’Encyclopédie SCIENCES) est offert pour tout achat
de sa version papier sur notre site, il vous sera envoyé après la finalisation de votre commande
Offre non applicable aux librairies
– Ebook (Collections classiques, Encyclopédie SCIENCES, Abrégés) :
Prix réservé aux particuliers
Pour les institutions : nous contacter
Nos ebooks sont au format PDF (compatible sur tout support)
Permettant, par exemple, d’alléger les matériaux structurels ou les emballages alimentaires, les polymères et composites sont omniprésents dans notre quotidien. Leurs performances dépendent non seulement de leur structure chimique, de leur synthèse, de leur architecturation et du procédé de mise en forme, mais elles évoluent également dans le temps sous l’effet de processus qui modifient, parfois lentement mais de façon irréversible, la structure du matériau.
Les utilisateurs doivent ainsi s’interroger sur la durée maximale d’utilisation pendant laquelle ces matériaux conservent des niveaux de propriétés acceptables. Ce questionnement est d’autant plus crucial qu’il répond aux exigences sociétales liées à la limitation des flux de déchets en fin de vie et à la préservation des ressources nécessaires à leur élaboration.
1. Aspects mécanistiques et cinétiques du vieillissement oxydant
2. Vieillissement des polymères en présence d’eau
3. Polymères sous rayonnements ionisants : introduction et principes de base
4. Stabilisation
5. Effet du vieillissement chimique sur les propriétés mécaniques
6. Le vieillissement physique par relaxation structurale dans les polymères
7. Quelques aspects de la fatigue des élastomères
8. Influence de la mobilité moléculaire du polyamide 6,6 et sur le comportement mécanique
9. Approche probabiliste de la dégradation des réseaux polymères
Emmanuel Richaud
Emmanuel Richaud est enseignant chercheur au laboratoire Procédés et ingénierie en mécanique et matériaux (Arts et Métiers ParisTech, CNRS et CNAM). Son activité de recherche porte sur la prédiction de la durée de vie des matériaux polymères et des composites.
Chapitre 1
Aspects mécanistiques et cinétiques du vieillissement oxydant (pages : 9-31)
Les polymères peuvent subir un vieillissement thermo-oxydant que l’on peut décrire comme un mécanisme radicalaire en chaine. Celui–ci résulte en la formation de composés stables (carbonyles, alcools), de coupures de chaines et/ou de réticulation. Dans les matériaux épais, la consommation de l’oxygène dans les processus oxydants s’accompagne d’un couplage avec les phénomènes de diffusion. Ces phénomènes sont décrits dans ce chapitre, ainsi que les bases des modèles cinétiques qui permettent la prédiction de la durée de vie.
Chapitre 2
Vieillissement des polymères en présence d’eau (pages : 33-53)
En présence d’eau, les polymères peuvent être sujets à deux modes de vieillissement : un vieillissement physique (a priori réversible) décrit par les mécanismes d’interaction eau-polymère et les mécanismes de diffusion de l’eau dans la matrice, ainsi qu’un mécanisme de vieillissement chimique (irréversible) correspondant à l’hydrolyse de liaisons esters ou amides. Ce chapitre expose les principaux mécanismes mis en jeu, quelques-unes de leurs conséquences sur les propriétés macroscopiques, ainsi que les modélisations pertinentes.
Chapitre 3
Polymères sous rayonnements ionisants : introduction et principes de base (pages : 55-107)
Les modifications radio-induites commencent par le dépôt d’énergie lors de processus d’interaction qui dépendent du type de rayonnement, de son énergie et de la composition du polymère. Les défauts finaux, découlant des espèces primaires radio-induits, et leur efficacité de création dépendent de paramètres intrinsèques au matériau et aux rayonnements et de paramètres extrinsèques tels que l’atmosphère et la température d’irradiation.
Chapitre 4
Stabilisation (pages : 109-134)
Le vieillissement des polymères peut être ralenti par l’ajout de stabilisants. Ce chapitre rappelle les principaux mécanismes d’action de ces derniers dans les cas du vieillissement thermique et photochimique, ainsi que des cas plus spécifiques (dépolymérisation, et deshydrochloruration du PVC), et enfin l’effet des phénomènes physique (notamment de migration) qui peuvent altérer leur action. Les méthodes de caractérisation simples sont également présentées.
Chapitre 5
Effet du vieillissement chimique sur les propriétés mécaniques (pages : 135-150)
Le vieillissement chimique des polymères s’accompagne de coupures et/ou de soudures de chaines. Leurs conséquences sur l’architecture macromoléculaire sont présentées dans le cas des polymères linéaires et des réseaux tridimensionnels, ainsi que leur effet sur les propriétés thermiques (notamment la température de transition vitreuse) et les propriétés mécaniques aux petites (module élastique) et aux grandes déformations (allongement à la rupture, ténacité). Des critères de fragilisation pouvant être déployés dans une approche multi-échelle de prédiction de la durée de vie sont également exposés.
Chapitre 6
Le vieillissement physique par relaxation structurale dans les polymères (pages : 151-239)
Les polymères subissent le vieillissement physique par relaxation structurale lorsqu’ils sont dans l’état vitreux. Ce chapitre aborde ce phénomène en rappelant tout d’abord les caractéristiques physiques de la transition vitreuse, puis en proposant quelques repères historiques dans l’étude du vieillissement physique par relaxation structurale, une revue des techniques permettant son investigation, son déroulé suivant la nature du polymère, et enfin quelques questions à solutionner pour progresser dans sa compréhension.
Chapitre 7
Quelques aspects de la fatigue des élastomères (pages : 241-272)
Les élastomères peuvent être sujets à de grands nombre cycles de sollicitation mécanique conduisant à un amoindrissement de leurs propriétés qui peut compromettre leur performance, on parle alors de dégradation en fatigue. Le présent chapitre propose de s’intéresser à la caractérisation du comportement en fatigue par approches en initiation au travers de la présentation d’un cas pratique mené sur le polychloroprène (CR) pour lesquels différents critères de fatigue (expérimentalement ou numériquement déterminés) et/ou représentations classiques sont explicités et utilisés.
Chapitre 8
Influence de la mobilité moléculaire du polyamide 6,6 et sur le comportement mécanique (pages : 273-304)
Ce chapitre traite interactions entre le PA6,6 et des solvants purs de polarités et tailles différentes mais aussi des mélanges ternaires composés d’éthanol, toluène et isooctane représentatifs de biocarburants. Il décrit comment la nature d’un solvant conditionne sa sorption et son effet plastifiant dans le PA6,6, le lien entre la nature et les interactions interchaînes de la matrice polymère et la prise en solvants. Une approche thermodynamique a été proposée pour étudier et comprendre la sorption de mélanges ternaires éthanol-toluène-isooctane et leur effet plastifiant dans le PA6,6. Enfin, il présente un lien entre les propriétés mécaniques du PA6,6 et l’état de mobilité moléculaire de la phase amorphe du polymère.
Chapitre 9
Approche probabiliste de la dégradation des réseaux polymères (pages : 305-318)
Pour les réseaux subissant une dégradation par coupure de chaines, la densité de réticulation va progressivement chuter alors que la fraction soluble va augmenter. Le point de « dégel » est atteint quand la densité de chaine élastiquement atteint est nulle. Ce chapitre présente une approche probabiliste qui permet de prédire l’évolution de la densité de réticulation (c’est-à-dire du module élastique), et de la fraction soluble, en fonction du taux d’avancement du processus de dégradation. Cette approche est appliquée à différentes configurations de réseaux différant par la fonctionnalité des nœuds de réticulation et le nombre de groupements réactifs porté par chaque chaine élastiquement active.